Il
n’a suffi que de quelques jours scandaleusement gorgés de soleil pour dévêtir
la ville du manteau sale de son hiver. Et nous voilà tout ébahis, rassurés de
voir ce printemps hâtif se faufiler autour de nos ombres, de nos pas, de nos
yeux plissés d’avoir trop longtemps hiberné entre les murs de briques.
Il
y a cette lumière franche qui vient éclabousser les draps dès l’aube, le cri
des oies en partance vers le Grand Nord et les chemises qui dansent sur les
cordes à linge des voisines.
Il
y a cette effervescence dans l’air, celle des moineaux ébouriffés qui
vocalisent d’indéchiffrables chants d’amour et de couvée. Celle des écoliers
qui font claquer leurs semelles neuves contres les cailloux que de dégel a
laissé sur les trottoirs. Celle des vélos qui dévalent les rues trouées par le
froid comme des chevaux tout justes déharnachés. Et celle des arbres,
mi-squelettes, mi-bouquets, prêts à
faire éclater au moindre signal la verdeur de leurs jeunes feuilles.
Cet
émouvant ballet bien rythmé d’une saison qui s’éteint pour laisser place à la
suivante est à la fois improvisé et immuable.
En
ce printemps de toutes les éclosions, moi aussi je m’apprête à faire le passage
entre deux saisons. À laisser glisser ces neuf mois de l’entre deux, l’entre
femme et mère. Ces neuf mois où l’on se sent peu à peu animée par un deuxième
cœur, une deuxième voix, jusqu’à ce moment tellement émouvant où l’on discerne
pleinement la présence de notre enfant. Cette saison de bouleversements, celui
d’habiter un corps que l’on partage, que l’on prête, d’habiter un corps
transformé dans sa chair, sa forme, sa destinée. Cette saison de plénitude. De
se sentir tant, tellement remplie par cette boule de vie mouvante et fragile,
mais aussi de cet amour qui chavire jusqu’aux larmes, quand on s’arrête
simplement pour être là, à deux. Des moments de grâce, qui laissent une traînée
de chaleur sur leur passage.
Et
puis il y a cette nouvelle saison dans laquelle plonger. Celle qui déposera sur
nos terres une famille. Et entre ces deux saisons un passage, grandiose et
inconnu.
En
attendant, me voilà ronde et lourde, plus éveillée que jamais à cet enfant qui
sera de ce côté-ci de l’univers dans quelques jours. Quelques douzaines
d’heures. Une pensée qui donne le vertige, qui avale tout pour ne laisser que
l’essentiel. Se rattraper du
vacillement par cet essentiel : le regard tendre et confiant de mon
bien-aimé. Et puis cet apaisement en déposant mes paumes sur ce ventre tendu
comme une peau de tambour : je m’apprête à devenir mère. C’est ce qui doit
être. Comme si la perspective n’avait plus beaucoup d’importance, que notre
localisation sur le grand trajet de la vie à ce moment précis était sans
conséquence, à cause de cette certitude. Celle de la suite des saisons. Être
profondément amoureuse d’un homme. Le savoir tout aussi amoureux. Porter,
donner naissance, voir grandir notre enfant. À la fois une évidence, et un
petit miracle.
. .
.
Alors
que ces mots se bousculent au bout de mes doigts, tout autour il y a le cri des
carouges dans les peupliers encore habillés des feuilles sèches de l’automne.
Devant, il y a la Rivière des Prairies, délestée de ses glaces, léchée par la
blancheur du soleil d’avril. Et il y a la tête de mon amoureux appuyée contre
ma tempe, alors que nous somme là à attendre paisiblement notre fils, en cet
après-midi de Pâques, à quelques souffles à peine du premier croisement de nos
regards.
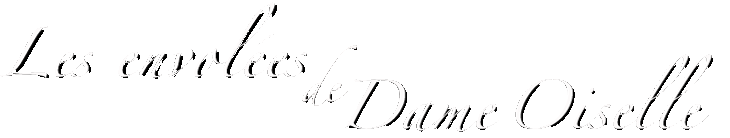






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire